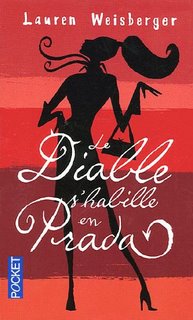Ma merveilleuse petite Chutnette a enfin vue le jour à la fin du mois dernier.
Ma merveilleuse petite Chutnette a enfin vue le jour à la fin du mois dernier.Après 41 semaines et 5 jours de gestation, les médecins ont décidé de la sortir de sa tanière manu militari à grands coups de scalpels et autres outils barbares faisant fi de toutes les images d’Épinal qu’une petite princesse était en droit d’attendre.
Les deux mains accrochées au cordon ombilical dans une version gore de Tarzan la banane, elle à surgit dans la sphère glaciale du bloc opératoire, quittant à regrets les douces entrailles qui l’avaient jusqu’alors bercées et nourries.
Ma tendre Chutnette est le plus beau de tous les cadeaux, de mon anniversaire où je découvrais son existence jusqu’à aujourd’hui, veille de Noël, elle n’a cessé de me faire des surprises, de m’émerveiller et de m’attendrir. Je lui dédicace ce blog en lui souhaitant d’aimer les livres aussi fort que sa maman les aime car c’est là aussi un amour étrange et pénétrant qui porte et qui transporte, qui vit sans préjugés et qui est une aventure intérieure intense et infinie.
Afin de ne pas perdre mes bonnes habitudes et pour plagier quelques blogs littéraires qui proposent leur sélection de l’avent, voici ce que j’espère bien trouver sous mon sapin aux cotés de Sophie la Girafe et du « J’élève mon enfant » de Laurence Pernoud.
- Séquence règlement de compte à O.K. Corral : Afin de prolonger mon expérience au sein des ateliers d’écriture, le très violent « A l’estomac » de Chuck Palahniuk.
- Emotions : Pour revivre d’un point de vue inhabituel la terrible journée du 11 septembre 2001, le « Extrêmement fort et incroyablement près » de Jonathan Safran Foer.
- Coup de gueule : Pour revendiquer mon côté militant et promouvoir un monde où les femmes pourraient s’épanouir sans préjugés ni violences, le récit poignant de Virginie Despentes « King Kong Théorie ».
- Avant que tout le monde se l’approprie sous les traits de Nicole Kidman : la biographie de l’extra-ordinaire photographe Diane Arbus qui voulait photographier le diable.
- Pour en voire de toutes les couleurs : « Métaphysique du chien » de Philippe Ségur pour faire rire les longues journées d’hiver et découvrir un auteur français pas assez reconnu et connu du grand public.
Voilà la petite sélection de Chutney, une vraie salade niçoise à déguster pour soi et à partager sans modération. Bientôt sur ce blog, la critique constructive de ces ouvrages si toutefois le père Noël a eu le temps de passer à la FNAC… Avis aux intéressés…
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes, de l’amour et de la joie en pagaille.
Offrez des livres !!